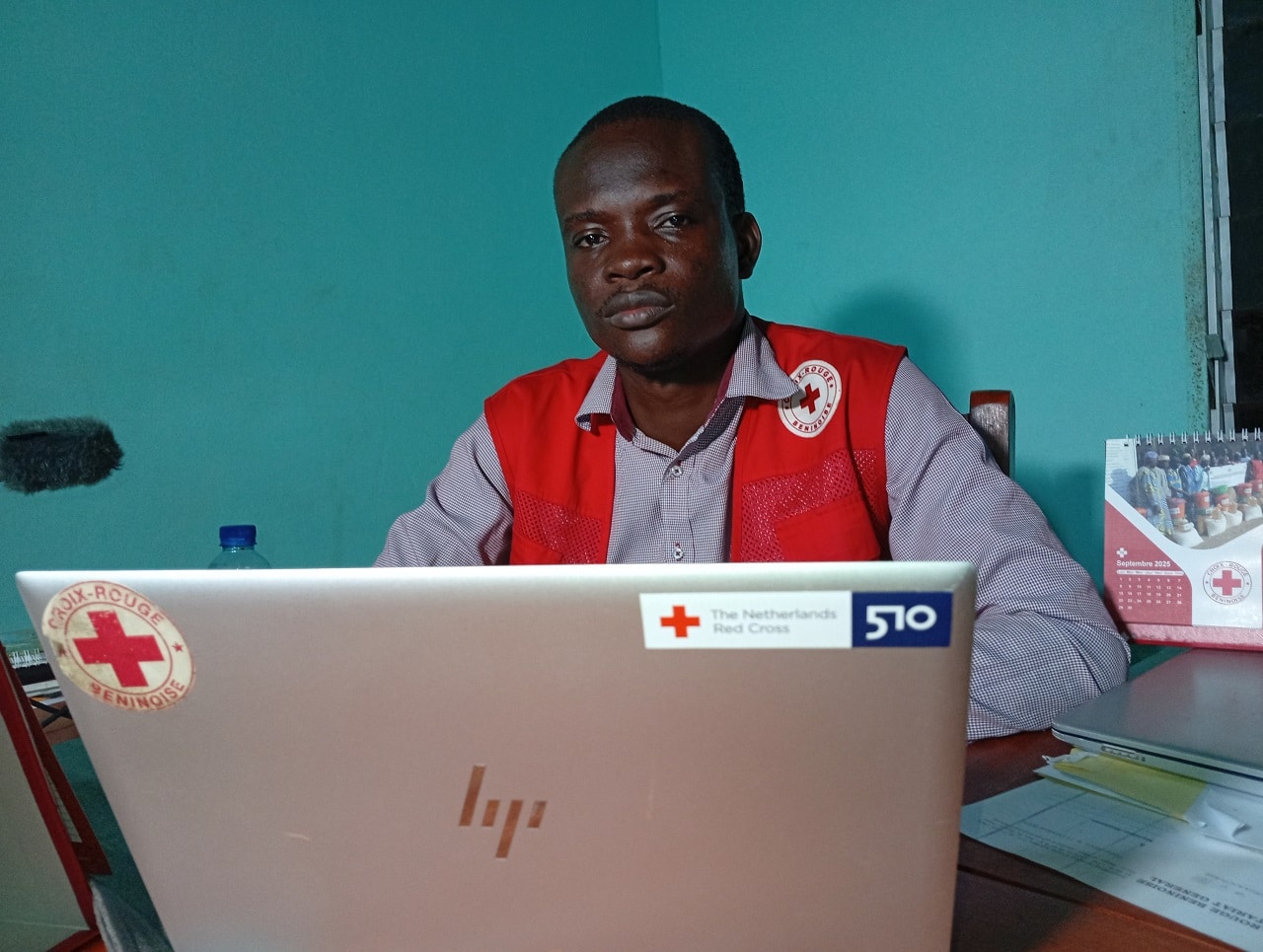Miodjou : Quels ont été les défis auxquels vous avez fait face lors de la mise en œuvre des activités du DREF – Mouvement de Population à Toucountouna et à Tanguiéta ?
Orens Houdegbe : Dans le cadre de cette opération d’urgence que nous avons réalisée avec le soutien de l’IFRC, les défis au début de la mise en œuvre de ce projet étaient vraiment énormes. Il s’agissait notamment de pouvoir effectivement assister les ménages victimes, les ménages qui se sont déplacés de Tanougou vers Tanguiéta et qui se sont retrouvés pour la plupart dans la commune de Toucountouna.
Le plus grand défi, c’était de pouvoir vraiment coordonner avec les autres organisations pour qu’il n’y ait pas vraiment de doublon par rapport au ciblage des bénéficiaires. L’autre défi, c’était de pouvoir organiser les activités de stratégie avancée, surtout avec le système sanitaire pour éviter que des populations soient bénéficiaires de nos stratégies avancées et, en même temps, des mêmes interventions auprès d’autres organisations.
Parlant de la collaboration avec les autres organisations, comment cela s’est passé ?
Dès que le DREF a été approuvé en juin 2025, nous avons organisé une première réunion de coordination qui était en même temps une réunion de lancement à laquelle nous avons invité tous les acteurs, les organisations humanitaires qui intervenaient dans le département de l’Atacora, les différentes mairies, les différents chefs de village et les CA qui étaient dans la zone d’intervention du projet. Nous leur avons expliqué les différentes activités. Nous avons ensuite demandé à ceux qui avaient des activités ou à qui voulaient se joindre à nous dans les différentes étapes du processus à bien vouloir le faire.
[…] accompagner le relèvement des communautés.
Au cours du processus, nous avons eu à collaborer avec certaines structures, notamment le Guichet unique de protection sociale, avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Nous avons également travaillé avec les centres de santé qui nous ont aidés et les organisations humanitaires qui sont sur place pour éviter les doublons. C’est avec eux que nous avons vraiment collaboré pour pouvoir atteindre les objectifs. Il est vrai que nous aurions voulu allé au-delà de ce que nous avons fait, mais le mécanisme de coordination prend du temps. C’est un processus d’apprentissage. Aujourd’hui, on peut se réjouir qu’on a fait un pas dans ce processus de coordination que nous avons mené en collaboration avec l’Agence béninoise de protection civile. Avec elle, nous échangeons régulièrement par rapport à l’avancée de l’opération et aux différentes informations dont ils ont besoin.
Quels sont les points forts et les limites de cette opération ?
Parlant des points forts, nous sommes aller au-delà des indicateurs annoncés. Nous voulions appuyer 500 ménages, mais nous sommes allés jusqu’à 503 ménages que nous avons pu assister et ces bénéficiaires ont reçu un transfert direct. Ils ont reçu les fonds sur leur numéro ou le numéro de quelqu’un qu’ils ont certifié. Il n’y a pas eu de fraude où quelqu’un aurait reçu les fonds à la place d’un autre. Il y a eu un contrôle sur cet aspect et je peux vous rassurer que les 503 bénéficiaires ont été appelés pour chaque transfert. Les bénéficiaires ont tous été appelés lors des trois transferts effectués et ils ont confirmé les avoir reçus.
L’autre point fort, ce sont les abris que nous avons pu réaliser sur le terrain. Les abris constituent un besoin criant. Ce que nous avons fait n’est pas totalement parfait, mais nous avons quand même démarré ce processus que nous allons améliorer dans les jours à venir. Par ailleurs, dans les localités les plus difficiles d’accès, nous avons pu déployer des volontaires, même des équipes de supervision pour nous assurer pour nous assurer de l’évolution de la construction des abris et du transfert du cash dans ces différentes localités.
En ce qui concerne les limites, nous devons travailler par rapport au relèvement des communautés à la base. Nous avons dépassé l’étape de l’urgence, nous devons donc pouvoir travailler et accompagner les communautés pour leur résilience. Je me réjouis qu’avec les fonds transférés lors de l’enquête, certains ménages ont acheté une machine à coudre par exemple. Cela fait partie du relèvement. Il va donc falloir que la Croix-Rouge Béninoise, ainsi que les partenaires qui nous accompagnent puissent voir dans la mesure du possible comment accompagner le relèvement des communautés. On ne va pas tout le temps parler d’urgence, mais on va également parler du relèvement et de développement.
Quelles améliorations proposeriez-vous pour les prochaines interventions ?
Pour les futures interventions, nous n’allons pas rester seulement dans l’urgence, il va falloir mettre en place des outils de relèvement des communautés. Et dès que nous finissons avec la phase de l’urgence, nous accompagnerons les communautés sur leur relèvement et voir dans la mesure du possible comment nous associer avec beaucoup d’autres organisations pour que les assistances soient un peu plus coordonnées et opérationnelles vers les communautés.
Qu’est-ce que la Croix-Rouge Béninoise fait aujourd’hui pour aider la communauté à être plus résiliente à l’avenir ?
Pour ce qui est de la résilience des communautés, la Croix-Rouge Béninoise travaille dans le cadre d’autres opérations à l’instar de l’accompagnement du CICR sur nos activités. Nous avons donné des semences aux communautés pour leur permettre de pouvoir faire l’agriculture. Il y a des groupes de maraîchers que nous avons identifiés et à qui nous avons donné des semences et du matériel.
[…] mettre en place un programme un peu plus résilient pour […] faire face aux défis […]
La dernière fois, nous avons donné des batteuses de riz à quelques communes du nord telles que Karimama et Malanville. En dehors de cela, nous accompagnons ces communautés sur les petites activités génératrices de revenus. Mais nous sommes plus focus aujourd’hui sur les questions de l’agriculture. Dans les jours à venir, nous allons nous accentuer sur cela et les étendre à plus de bénéficiaires. Aujourd’hui, en termes d’assistance, la plupart s’arrêtent au niveau des semences et du matériel.
L’approche engagement communautaire et redevabilité nous oblige à repartir sur le terrain, à voir avec eux ensemble quelles sont les activités génératrices de revenus, comment ils veulent qu’on les accompagne afin de pouvoir leur donner une résilience. La plupart sont des agriculteurs, on imagine déjà le problème des terres qui vont se poser dans ces différentes localités. Il va falloir réfléchir à tous ces aspects afin de pouvoir mettre en place un programme un peu plus résilient pour leur permettre de pouvoir faire face aux défis et arrêter d’être tout le temps en attente de l’assistance venant des structures humanitaires.