Ustensiles de cuisine anti-adhésion, embouts buccaux de cigarette électronique, semelles de fers à repasser ; lubrifiants et cires pour sols et voitures, dans la fabrication de cosmétiques ou encore agents antibuée, antistatiques ou réfléchissants pour vernis et peintures ; etc. Voilà autant de choses qui contiennent les PFAS.
Les PFAS sont des composés chimiques ultra-résistants, omniprésents dans l’environnement, et l’Afrique n’y échappe pas. Utilisés dans des produits de consommation courante comme les textiles imperméables, les emballages alimentaires ou les mousses anti-incendies, ces polluants qualifiés d’éternels s’accumulent dans l’eau, l’air et les sols. Si la contamination est bien documentée en Europe et en Amérique du Nord, les données sur l’Afrique restent insuffisantes.
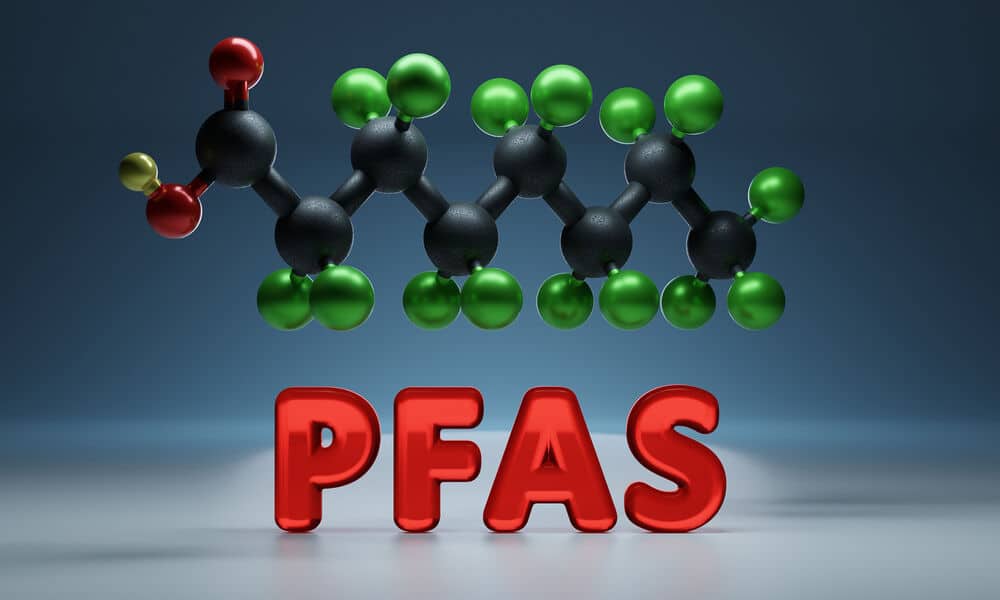
PFAS en Afrique : urgence d’agir !
En effet, les études menées, notamment en Afrique du Sud, selon ce que rapporte Rfi, montrent des niveaux de pollution comparables à ceux des pays industrialisés, notamment autour des aéroports, des stations d’épuration et des décharges où finissent de nombreux déchets importés. Ce manque de surveillance est d’autant plus préoccupant que les PFAS sont associés à de graves problèmes de santé : cancers, troubles hormonaux, maladies cardiovasculaires et affaiblissement du système immunitaire.
Or, les réglementations restent quasi inexistantes sur le continent, à l’exception de l’Afrique du Sud qui a instauré des limites sanitaires. Face à cette menace silencieuse, il est nécessaire et urgent d’investir dans la recherche et d’établir des normes de protection pour limiter l’exposition des populations africaines à ces substances toxiques.

